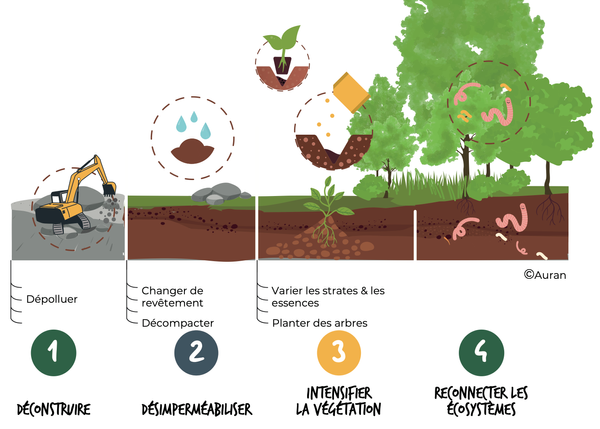Bellevilles, foncière solidaire


Sylvain GRISOT > Bonjour à tous les deux. Tout d’abord, pourriez-vous vous présenter ?
Alexandre BORN > Bonjour. Je m'appelle Alexandre Born. Je suis l’un des cinq co-fondateurs de Bellevilles, et j'en suis aussi le directeur général.
Sébastien DE HULSTER > Sébastien De Hulster, je suis aussi l’un des cinq co-fondateurs associés. J’ai également une activité de foncière commerciale, De Watou, qui est l'entreprise familiale que je gère avec mon frère. C'est grâce à ça qu'on s'est connu avec Alexandre.
Avant qu’on rentre dans le détail de ce que fait la foncière Bellevilles, qui n’intervient assurément pas qu’à Paris, pouvez vous nous expliquer ce qu’est une foncière et l’approche un peu particulière que vous en avez ?
Alexandre Born > Une foncière peut acheter des immeubles, des logements, des locaux d’activités et de commerce. Elle les détient sur une durée longue, avec une logique patrimoniale. Cela veut dire qu’elle les garde, elle ne les revend pas forcément. Une foncière classique achète, gère et loue à des locataires.
Il y a des foncières dans le marché du commerce et du tertiaire, moins sur la question du logement. Elles se distinguent de la promotion immobilière, car elles sont dans une logique de temps long. Quels sont vos partis pris à la foncière de Bellevilles ?
Alexandre Born > Tu as évoqué le temps long, c’est essentiel et c’est notre point de départ. Derrière la foncière, il y a la volonté de casser la chaîne de l’immobilier souvent basée sur une logique très court terme : j’achète, je revends, je gagne vite de l’argent. La foncière est un outil du temps long.
Nous avons créé une entreprise solidaire d’utilité sociale. Le premier objectif de notre foncière est donc de servir l’intérêt général, ou une cause écologique, sociale, voire économique. Nos efforts et nos actions sont portées là-dessus.
Est-ce que tu peux nous expliquer ces questions de temporalités ? Quels sont les problèmes avec le temps court ?
Alexandre Born > Il y a de très bons promoteurs qui construisent bien, mais qui sont tout de même soumis à l’injonction d’un investisseur, qui lui dicte son enjeu propre. Le promoteur réagit à cela et construit ce qu’on lui demande, en revendant dans un temps qui est court, c’est-à-dire 2 à 5 ans maximum. La rémunération d’un promoteur est faite sur sa capacité à créer cette valeur, quand bien même elle serait raisonnable. Il a donc intérêt à ce que le bâtiment soit vendu au plus vite. Alors que la foncière a plutôt intérêt à que son locataire soit content et stable. C’est inhérent au statut de foncière que le locataire se sente bien. Elle investit donc dans une certaine qualité, plus que si elle était dans cette logique de court terme.

Cela change donc la façon dont on construit ou on réhabilite, et la façon dont on gère les bâtiments. Si vous vous distinguez sur les objectifs, en quoi cela vous distingue aussi dans vos façons de faire la ville ?
Sébastien De Hulster > Chez un opérateur classique, l’objectif est la création de valeur, au profit d’un investisseur, d’un associé ou d’un dirigeant. Avec Bellevilles, on ne veut pas participer à la spéculation immobilière qui génère beaucoup d’externalités négatives dans la construction de la ville. On ne souhaite pas que cette valeur soit captée par un petit groupe d’associés, mais bien par l’exploitant, celui qui va utiliser le lieu au quotidien.
Pour bien comprendre comment cela se déroule entre tous les acteurs, peut-on rentrer dans le concret ? Pouvez-vous nous raconter des exemples de bâtiments sur lesquels vous travaillez ?
Alexandre Born > On a mis trois ans à rationaliser nos investissements, car beaucoup de domaines nous intéressaient. Finalement, ces investissements se regroupent en quatre catégories. La première est les cœurs de ville ou de village. La vocation est de créer ou de participer à une dynamique de création de commerce, d’activités et de logement en cœurs de villes, parfois délaissés.
La deuxième partie, ce sont des locaux liés à la création. On les loue à loyers modérés à des acteurs de l’ESS, des artisans ou des acteurs de la culture. La pression foncière dans les métropoles fait que ces acteurs sont souvent relayés aux franges de la ville.
Le troisième axe se focalise sur les tiers-lieux. Par la force des choses, on a été amené à intervenir sur ces projets, comme les Halles de la Cartoucherie. Comme on accorde une grande importance à la force du collectif, on essaye aussi d’aider à l’émergence de projet localement.
La dernier, c’est le logement, pour répondre à la crise du logement et de l’hébergement d’urgence. On n’a pas encore de projet en hébergement d’urgence, mais on y aspire.
Tu citais la Cartoucherie : quel est ce lieu, le projet et qu’est-ce que vous y faites ?
Sébastien De Hulster > C’est notre premier projet, notre rencontre s’est faite autour de ce lieu. C’est un tiers-lieu de 13 000 m2 à Toulouse. Il y une salle de spectacle, une salle d’escalade, des terrains de squash, du coworking sur 3000m2 et aussi une halle gourmande avec une trentaine de stands de restauration. Bellevilles a aidé à financer le projet et à le concevoir : le structurer, rassurer les collectivités, rassurances les financeurs comme la Caisse des Dépôts, en montrant qu’il y avait un acteur qui maîtrisait l’immobilier et qui pouvait coordonner tous les autres.
Puis, on est entré dans la gouvernance du projet. On n’est pas simplement un acteur immobilier qui détient les murs mais on intervient aussi au niveau des sociétés d’exploitation, notamment au sein d’une coopérative, la SCIC Cosmopolis mais aussi dans d’autres sociétés d’exploitation des Halles de la Cartoucherie. C’est aussi une spécificité de Bellevilles par rapport à d’autres foncières.
Il y a quand même eu une grosse réhabilitation du lieu, avec 20 millions d’euros de travaux. Bellevilles a travaillé sur la partie technique, le CPI (contrat de promotion immobilière), la programmation, les relations avec les bureaux d’études, les architectes… Le lieu va ouvrir le 1er septembre et on participe encore à toutes les étapes du projet.

Vous travaillez donc à la fois sur la question de la propriété, mais aussi celles des financements, de la maîtrise d’ouvrage des travaux, de la gouvernance… En quoi ce projet est un bon exemple de ce que vous faites, ou au contraire, une exception ?
Sébastien De Hulster > C’était un premier projet, autour duquel on s’est rencontré. On a croisé nos convictions sur l’immobilier, qui m’ont beaucoup éclairé, car je viens de l’immobilier de commerce. Ce projet nous a amené vers d’autres tiers-lieux. On a une forte visibilité en accompagnement de tiers-lieux. Mais il est singulier, car c’est un gros projet. Mais on n’a pas deux projets qui se ressemblent. Parfois, il y a des projets qui ont déjà des idées de programmation auxquels on vient simplement donner un coup de main.
Alexandre Born > Il est important de noter qu’on ne se substitue pas aux porteurs de projet ou au collectif. On vient davantage en réaction pour structurer. On découvre quand même des points communs entre tous ces lieux et on a développé des automatismes, avec des projets axés autour d’une volonté citoyenne. Le porteur de projet ne vient souvent pas de l’immobilier, alors qu’il ou elle va se retrouver à la manette de tout un projet financier, de construction, d’exploitation… C’est impossible de réunir toutes ces compétences, sachant que le ou la porteuse de projet s’expose déjà beaucoup humainement. Notre premier travail est d’alerter sur ce point et d’identifier le risque, qui est souvent humain avant tout. Même si on met beaucoup d’énergie dans des projets, c’est moins émotionnel pour notre équipe. On peut rationnaliser, ce qui permet au porteur de projet de prendre du recul. Dans ces projets, on doit trouver la bonne place pour chacun, y compris la nôtre.
Pourquoi est-ce que cela peut être compliqué ? A contrario, qu’est-ce qui fait que cela fonctionne ? Qu’est-ce qui fait qu’un projet ou un lieu va vous intéresser ? Il y a plein de projets nécessaires socialement qui ne sont pas viables économiquement.
Alexandre Born > Bien sûr, le préalable est de savoir à quel besoin répond le projet. Le vrai risque est de ne pas savoir diagnostiquer un projet engagé de ce qui n’en est pas un. C’est un gros travail pour notre équipe d’analyser la fiabilité humaine, économique et l’ancrage. S’il n’y pas de portage politique par exemple, c’est un gros problème pour nous. Si la démarche est contraire à la protection des ressources naturelles, c’est aussi un problème. Finalement, on s’inspire beaucoup de l’analyse de risque de n’importe quel investisseur, car on n’est pas exempt de cette nécessité de bien investir et d’être précautionneux en termes de rentabilité économique. Même si on en attend moins, tous nos projets sont à l’équilibre. Ce ne sont pas des utopies, ce sont des projets réels qui doivent répondre à un besoin. On fait beaucoup de projets collectifs, comme les tiers-lieux, mais on a besoin de projet où on est plus autonome, comme du logement. On n’a pas besoin d’être un collectif pour rénover un immeuble de logement. On doit diversifier nos investissements pour compenser le risque de certains projets.
Pourriez-vous revenir sur l’économie du projet ? S’il y a portage politique et une vocation sociale au projet, y a-t-il des modes de financement associés ?
Sébastien De Hulster > On veut être sûr qu’il y ait un portage politique dans le sens où le territoire accueille le projet avec bienveillance. Mais il n’y a pas nécessairement de portage financier de la part de la collectivité.
On est très proche d’un modèle classique de foncière, mais comme la finalité est différente, on peut aussi capter des subventions, savoir où elles sont et taper à la bonne porte au bon moment. On est souvent bien accueillis, car c’est difficile de trouver de bons projets et d’être sûr que l’argent va être bien utilisé. L’ANCT nous soutient et le fond friche nous a aussi permit de sortir des projets. A Verdun, par exemple, si on n’avait pas eu de subventions, le projet n’aurait pas tenu économiquement. La collectivité aurait pu le porter, mais cela aurait été de l’argent public mal utilisé, alors qu’un acteur privé en co-association avec la Caisse des Dépôts peut le faire.
Il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Nos projets ont un endettement bancaire, généralement 70% de dettes bancaires et 30% en fonds propres. Cela génère donc des remboursements tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, qu’on met face à des loyers. Notre objectif étant de baisser le plus possible les financements pour baisser le plus possible les loyers.

Vous mobilisez aussi des fonds propres, avec beaucoup d’acteurs autour de la table, ce qui rajoute du risque. Plus on multiple les maillons, plus on prend des risques de rupture. La gestion de votre risque est aussi d’avoir de nombreux projets pour supporter les échecs. Comment gérez vous ce passage à l’échelle ?
Alexandre Born > On n’essaye pas de se développer, mais on essaye de répondre à un besoin et ce besoin est croissant. Besoin de tiers-lieux, besoin de locaux d’activité, besoin de logements… Tant qu’on sert cette cause, on ne va pas manquer de boulot. Ce qui veut dire que nous avons besoin de plus de fonds propres. On a réussi, avec l’aide de tous les associés, à lever neuf millions sur les trois premières années. Mais devant nous, il y a encore un nombre énorme de projets qui nécessite des fonds propres importants. On travaille beaucoup à ce passage à l’échelle, et si on n’a pas la prétention de faire bouger toute la chaîne de l’immobilier, on peut au moins y participer.
On a des exemples concrets d’immeubles qu’on a acheté au prix du marché et qu’on a reloué bien moins chers. Cela intéresse des fonds d’investissement, cela intéresse la Caisse des Dépôts, mais aussi plein de gens de l’immobilier et de la finance. Il y a une injonction à flécher des capitaux vers la finance et les investissements solidaires. Notre enjeu, à Bellevilles, est de montrer qu’on est capable de capter ces capitaux et de les flécher sur des projets qui ont du sens.
Quels sont les freins aujourd’hui ? Quelles peuvent être les difficultés liées au marché, aux territoires ou à l’organisation ?
Sébastien De Hulster > Ce qui est amusant, c’est que dans l’immobilier classique, ce qui est difficile, c’est de trouver des projets, pas de trouver de l’argent. Avec Bellevilles, on a énormément de sollicitations de projet. La difficulté est plutôt d’être sûr d’aller sur des projets avec des personnes engagées, qui ne sont pas hors-sol. C’est ce qui est vraiment le plus compliqué. Par exemple, un porteur de projet va proposer un projet culturel très positif dans un quartier spécifique, mais qui ne s’adresse pas du tout aux gens du quartier. Il y a des polémiques autour des tiers-lieux sur ces sujets : est-ce qu’on ne créé pas des endroits à bobos où les personnes du quartier ne s’y retrouvent pas du tout ? On essaye d’être vigilant là-dessus, pour que les personnes visées s’emparent du projet.
Bellevilles a trois ans, notre équipe compte une trentaine de personnes, associés compris. C’est une société en croissance, avec tout ce que cela peut générer, mais ça se passe très bien, je trouve. Il y a un point d’attention à avoir sur la volonté de changer les choses et donc du sacrifice personnel que cela peut impliquer. Au niveau des associés, on a mis beaucoup d’énergie, mais on a trouvé le bon équilibre. Au niveau des équipes, cela peut être difficile de s’engager dans un lieu ouvert 7/7 jours, avec une super programmation, et de prendre aussi du temps pour soi. C’est quelque chose que tous les porteurs de projet traversent à un moment donné.
Alexandre Born > La question est aussi de trouver notre place dans les projets. Comment entrer dans un projet avec une approche professionnelle sans brusquer les intentions initiales ? Comment faire comprendre que l’idée est bien, mais que l’organisation mise en place n’est pas fonctionnelle ? Parfois, très concrètement, on doit dire à un porteur de projet que c’est contre-productif d’aller voir toutes les banques de France, car ce n’est pas un financier. Comment lui faire accepter de lâcher cette partie-là ? Comment lui inspire-t-on confiance sans écraser le collectif ? On n’a pas trouvé de recette toute faite pour ça. On est attentif à laisser un maximum de place au porteur de projet, y compris lors du tour de table avec les investisseurs.
Une autre difficulté est de faire comprendre notre modèle économique et de parler d’argent de la bonne manière dans des projets engagés. Cela peut être tabou de se payer ou d’être « trop » payé. Dans la finance et l’immobilier, les salaires sont délirants. C’est beaucoup trop, mais il faut aussi qu’on recrute des talents. Nos salaires sont beaucoup plus raisonnables que dans l’immobilier (salaires de 1 à 2,4) mais ils peuvent paraître encore trop élevés pour le domaine de l’ESS. On doit expliquer à nos partenaires que l’on doit être rémunéré correctement, avec des équipes qui n’ont pas trop de projet en même temps. Tout est le monde est d’accord avec ce discours, mais dans les faits, cela nécessite encore de la pédagogie.
Vous vous retrouvez un peu entre deux mondes, comme des passeurs entre le monde de la finance, de l’économie et de l’immobilier, et celui des idées et de l’engagement.
Sébastien De Hulster > Le point fort de Bellevilles est de faire le lien entre ces deux mondes. On a un pied de chaque côté et on joue beaucoup ce rôle de traduction. On parvient à rationaliser comment les gens se voient entre eux. Les acteurs associatifs, ou autres collectifs engagés, savent aussi qu’ils ont besoin d’un modèle économique et d’une pérennité. De même, on peut traduire aussi les besoins et les craintes que peuvent avoir les financeurs ou les collectivités. C’est à nous de jouer ce rôle là et de trouver les bons modèles. Il nous reste encore beaucoup de chose sur lesquelles innover, comme la lucrativité limitée. Aujourd’hui, Bellevilles est une SAS, il y a donc un engagement des associés à ne pas s’enrichir, mais c’est un processus qui n’existe quasiment pas juridiquement. On aurait pu créer une SCIC, mais la lecture d’une SCIC peut être compliquée pour des financeurs, on aurait pu rencontrer des difficultés à lever des fonds. On essaye d’innover en trouvant des solutions à cheval entre les deux mondes. De temps en temps, on est un peu schizophrène, mais on est reconnu pour ça.

Reconnu et appelé, car les projets viennent à vous. Est-ce que cela veut dire qu’il n’y a pas assez de passeurs, de traducteurs dans ce domaine ? Pour enclencher un passage à l’échelle, il faudrait qu’il y ait d’autres acteurs comme vous.
Alexandre Born > On est plutôt les derniers que les premiers. On s’est très largement inspiré de Terre de Liens, de Villages Vivants, d’Habitat et Humanisme ou de la foncière Chenêlet. Il y en a d’autres et il y a aussi les bailleurs sociaux. On s’intéresse beaucoup aussi à la foncière Antidote, qui est assez radicale et qui ne veut pas faire appel à la dette. C’est très bien, même si pour le moment on n’a pas réussi à adresser aussi fortement la question de l’anti-spéculation. On joue avec nos cartes pour participer à changer le système capitaliste et financier. On sert la même cause, on se fait confiance, ce sont des organisations avec lesquelles on collabore de de près ou de loin. On a aussi un groupe de travail autour de ces questions avec Base Commune, Bien Commun et Villages Vivants.
Bellevilles est une SAS détenue par cinq personnes physiques qui sont donc actionnaires d’une entreprise, qui a telle valeur aujourd’hui et qui aura telle valeur demain. On est en train de signer un pacte d’associés qui implique un transfert total et gratuit de nos parts à un outil non lucratif. Cela pourra être une SCIC, une fondation, un fonds de dotation… Peu importe. Ce qui est clair, c’est qu’on ne s’enrichira pas personnellement sur le dos de Bellevilles et des subventions qu’on a touché. On remercie d’ailleurs tous ces acteurs qui nous font confiance alors qu’on n'avait pas encore trouvé la bonne manière de verrouiller notre engagement à ne pas nous enrichir personnellement, malgré notre statut de SAS.
Revenons d’ailleurs sur les cinq mousquetaires de départ. Quelle est votre histoire personnelle ? A quel moment dans une carrière professionnelle on se lance dans un projet si compliqué ?
Alexandre Born > On est quatre à s’être connus à l’école. On a fait nos études sur l’urbanisme et le bâtiment ensemble. On a chacun pris des chemins différents : François dans l’architecture, Jérémie dans l’ESS, Adrien dans le logement social et moi dans l’immobilier. Au fil des années, on avait chacun des frustrations et des difficultés à comprendre pourquoi on faisait ce métier, pourquoi on créait des bureaux neufs alors qu’il y a des bureaux vides à côté, etc.
La meilleure manière pour nous de comprendre tout cela était de le faire nous-même. On a voulu maîtriser en totalité la chaîne de valeur. Jérémie travaillait sur les Halles de la Cartoucherie, il a co-fondé le projet. Il a appelé Sébastien à l’aide, qui a largement participé à faire financer le projet. On était en train de monter Bellevilles, avec une pluralité de compétences. La rencontre avec Sébastien a donc été logique.
Sébastien De Hulster > Cela s’est créé assez naturellement. A cinq associés, on parvient à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, c’est-à-dire tous les maillons de la fabrique de la ville et de l’immobilier. On ne sait pas tout faire, mais on a des connaissances dans plusieurs domaines.
Ma connaissance, par exemple, c’est l’immobilier de commerce. Je suis dans ce métier depuis 2004. Je finissais par me demander à quoi cela servait de faire de l’immobilier, mais quand j’ai travaillé sur le programme de la Cartoucherie, cela a fait sens. L’immobilier c’est bien, c’est la finalité qui doit être différente. Maîtriser toute la chaîne de valeur, c’est aussi essayer de réduire les coûts et les intermédiaires, comme le commerce équitable de l’immobilier, mais avec un esprit très collaboratif. Le nombre d’acteurs sur chaque projet est gigantesque, il faut aussi aller chercher des compétences ailleurs.
Alexandre Born > On revendique cette place d’entre-deux, parce que je pense que si on veut participer à un changement systémique, c’est en allant chercher dans les deux mondes. Je n’aime pas trop la position parfois très dogmatique qui voudrait qu’on ne travaille que avec l’ESS. Un pizzaiolo crée aussi deux ou trois emplois et de la valeur. On aime bien s’attacher à comprendre l’ambiguïté, la complexité qu’il y a derrière la création d’une entreprise.
L’entreprise de Sébastien, De Watou, est une foncière familiale qui fait très bien son métier, qui ne communique pas ses rabais de loyer quand un locataire est en difficulté et qui a pris des positions d’investisseurs de bon sens. On a fait différemment avec Bellevilles, mais il y a plein de gens dans le monde classique qui font très bien leur métier, sans le crier sur tous les toits.
Sébastien De Hulster > Je me considère comme la dernière pièce du puzzle, car je n’aurais jamais pu créer Bellevilles, mais Bellevilles se serait créée sans moi. Aujourd’hui, De Watou n’a plus pour objectif de grandir. On continue les acquisitions, mais elles doivent avoir du sens. Ce n’est pas aussi pointu que l’équipe de Bellevilles, je ne revendique pas ce rôle-là. Mais j’apprends tous les jours au contact de l’équipe de Bellevilles, car quand tu rentres dans l’immobilier, ton objectif est de grandir le plus possible. Si tu es promoteur, c’est de construire le plus de m2 possible. Si tu es une foncière, c’est d’avoir le plus de patrimoine possible. Aujourd’hui, je m’oriente davantage sur de l’accompagnement de projets de territoire, type foncière de territoire, où Bellevilles n’a pas forcément sa place.
Le modèle de Bellevilles essaime donc jusqu’à se dire de faire bien plutôt que de faire plus ?
Sébastien De Hulster > Oui, et je ne l’aurais jamais imaginé il y a deux ans. La première fois qu’on m’a parlé de décroissance, je me suis dit que la personne était timbrée. Aujourd’hui, je suis convaincu par la décroissance économique. J’accompagne des entreprises dans le réseau Entreprendre et j’entends encore beaucoup de personnes dont l’objectif est de grandir. Bien sûr qu’on pourrait avoir une vision de Bellevilles, dans 15 ans, à 2000 salariés, avec une agence dans chaque ville. Mais ce n’est pas ce qu’on veut. On espère plutôt être un modèle qui va permettre à d’autres personnes de faire ce qu’on fait, mais à leur manière.

Comment est-ce qu’on essaime alors ? Ce modèle d’entreprise et ce modèle d’action sont-ils réplicables ?
Alexandre Born > D’abord, il faut qu’on comprenne bien où on a le plus d’impact, et ce n’est pas en devenant les plus gros que cela se fera. On a participé à changer la trajectoire de De Watou, c’est déjà beaucoup. Il y plein de mastodontes du domaine qui sont en train de changer de trajectoire. S’ils le font sincèrement, on peut travailler ensemble. Souvent, les gens qui composent ces organisations ont envie de bien faire, mais sont pris dans un système avec une injonction à dégager des dividendes. Ça peut changer, mais ça va prendre du temps.
A 5 ans, il faut qu’on continue à être une foncière et à investir, parce qu’on a besoin de faire. On n’est pas une boîte de conseil, on fait les choses concrètement. On a besoin de continuer à se professionnaliser. On va aussi continuer à capter, pour nous ou pour d’autres, des capitaux pour répondre à tous les projets qu’on a devant nous. J’espère que cela percolera dans l’écosystème, même les plus classiques. Peut-être que si certains baissaient leur exigence de rendement, ils ne s’en sortiraient pas plus mal, et leurs collaborateurs et collaboratrices seraient plus heureux.
Sébastien De Hulster > Dans ces organisations, il y a des modèles qui existent depuis 40 ans. On ne sait même plus qui a décidé de le faire comme ça. Nous, on veut changer ces modèles.
Cela paraît surréaliste et exceptionnel, mais cette entreprise ne nous appartient pas et le poids des fondateurs ne doit pas exister. Coluche a réussi à faire que les Restos du Cœur ne sont plus associés à lui. On souhaite que cela ne soit pas les cinq associés qui fassent Bellevilles. Il y a des personnes qui travaillent tous les jours sur ces projets, qui adaptent l’organisation et qui en font quelque chose de bien. On n’a rien à réclamer parce qu’on a pensé l’idée en premier. Je découvre cette façon de penser et je trouve ça exceptionnel.
Alexandre Born > C’est la meilleure manière de pérenniser. Moins on sera indispensable, plus le projet sera pérenne. Si demain matin, on en a marre et si on est indispensable, alors il n’y aura plus de projet. C’est déjà quasiment plus le cas. On a vocation à court terme à ralentir, bosser moins et faire d’autres choses qu’on aime.
Sébastien De Hulster > Les entreprises qui passent à quatre jours sont aussi productives qu’avant. C’est un leurre de continuer de faire des semaines de 70 heures. Sur les cinq associés, il y en a deux qui sont à plein temps sur Bellevilles, Alexandre et Adrien, et trois autres avec une activité à côté. Le poids sur les associés redescend. On doit montrer aux salariés que la semaine de quatre jours fonctionne dans beaucoup de société.
Vous avez déjà fait beaucoup de choses, même si on a bien compris qu’il restait du chemin et plein d’expérimentations. Un modèle qui peut essaimer, donner envie à d’autres et qui pousse vers une redirection des organisations. Merci beaucoup pour cet échange et bravo pour le travail accompli.
Propos recueillis par Sylvain Grisot, février 2023
Pour aller plus loin :
- Le site web de Bellevilles
- Bellevilles clôture une levée de fonds de 4M€
- La ville solidaire de Bellevilles, podcast Cause Commune, décembre 2022