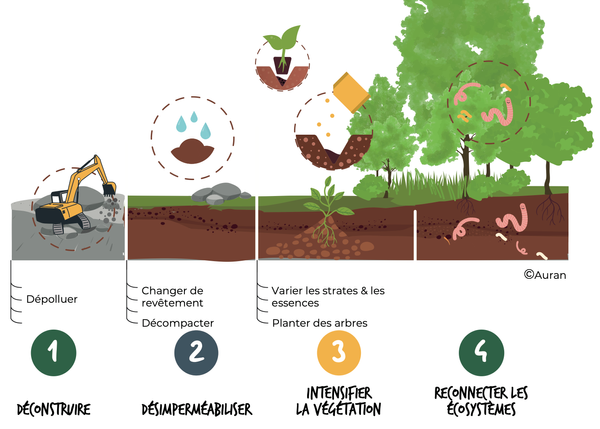Le réveil de Mayotte : Chronique post-Chido

Le 14 décembre, quelques heures après le passage de Chido, nous retrouvons nos maisons inondées, éventrées, leurs toitures dispersées comme des feuilles mortes. Dans nos rues, sur nos places publiques, un nouveau paysage s’est dessiné : ici la tôle du voisin, là-bas une charpente méconnaissable. Les troncs massifs, déracinés par la fureur du cyclone, barrent les routes comme des barricades naturelles, tandis que les câbles électriques tissent une toile chaotique autour de ces débris. Les voitures, abandonnées à leur sort, ne sont plus que des carcasses tordues.
En observant les impacts violents sur nos murs, nous reconstituons, tels des détectives improbables, le voyage destructeur de la cuve de la mosquée, le parcours fatal de la charpente de l’école. Dans ces premières heures, l’urgence est aux corps. Il nous faut des bras, de la force vive pour libérer les routes, des mains pour bâcher les maisons béantes. Il nous faut des jambes, du souffle, pour traverser l’île et nous assurer que nos proches respirent encore. Ils respirent, oui, mais notre île est méconnaissable, inhabitable.
Curieusement, notre esprit refuse d’abord d’accepter ce bouleversement radical de nos vies. Que lundi, nos chantiers resteront figés, nos bureaux vides, notre quotidien suspendu. Nous nous interrogeons sur l’écho de notre détresse là-bas, dans l’hexagone. Le réseau, capricieux quand il n’est pas totalement muet, nous maintient dans une bulle d’isolement, ignorant de la perception métropolitaine de notre chaos.
Sans nos arbres protecteurs, nous suffoquons sous un soleil implacable. La poussière devient notre seconde peau et, chaque soir, nous comptons les gouttes de nos douches économes, puisées dans nos maigres réserves. Les dîners se prennent à la chandelle dans une obscurité devenue familière. Nous rationnons l’essentiel : l’eau, l’essence, la nourriture, jusqu’à l’énergie de nos téléphones devenus muets. Au réveil, nos espoirs se font modestes, terre à terre : retrouver l’eau courante, la lumière électrique, voir enfin les rideaux de fer des magasins se lever pour reconstituer nos provisions.
Nous ne nous plaignons pas tout de suite de la fatigue. Depuis Chiconi, chaque jour, tronçonneuse en main, nous creusons notre chemin comme des mineurs à ciel ouvert. Une chorégraphie infinie s’installe : déplacer une charpente, puis une autre, dégager un arbre, puis son voisin, écarter un bosquet de bambou, puis le suivant. Le troisième jour, Mamoudzou nous apparaît enfin, et le spectacle nous frappe d’un silence assourdissant, comme un coup sourd dans le ventre. Pas une tôle n’a résisté à la fureur de Chido. Les collines, autrefois parsemées de bangas, ces fragiles maisons en tôle, semblent maintenant pleurer leurs habitations blessées.
Dans cette désolation, un concert de marteaux rythme les journées. L’île entière s’est muée en une immense équipe de nettoyage, comme si nous participions tous à un grand ménage collectif, un ménage qui efface les traces d’une catastrophe. La solidarité jaillit de partout, et miraculeusement, les sourires persistent. Nous sourions parce que nous sommes là, vivants, parce que chaque ami retrouvé est une victoire sur le chaos. Je contemple ce tableau paradoxal, oscillant entre l’horreur et la beauté : la destruction massive et la force de notre humanité qui se relève. Je ne sais plus si je dois pleurer devant la dévastation ou m’émerveiller devant cette solidarité qui nous unit tous.
Le 17 décembre, Keyvan Fathi envoie un message aussi bref qu’essentiel sur notre groupe de copains : « Demain matin rdv à la DRU de Mamoudzou pour tous les archis motivés et dispos », suivi d’un cœur. La concision est de mise dans ces moments où chaque octet de données compte. Le message se propage comme une onde, et le 18 au matin, nous formons un cercle d’une vingtaine d’architectes, l’esprit déjà tourné vers l’action. La mairie de Mamoudzou, à travers Keyvan, nous mandate officiellement pour une mission bénévole : diagnostiquer l’ensemble de ses bâtiments.
L’urgence se décline en trois objectifs cruciaux. D’abord, la sécurité immédiate : les écoles servent encore de refuges à de nombreux sinistrés qui y resteront tant que leurs maisons ne seront pas habitables. Notre première tâche est d’évaluer si ces havres improvisés peuvent continuer à protéger leurs occupants. Ensuite, l’état sanitaire, à communiquer à l’ARS. Sans eau courante, la situation est apocalyptique : les toilettes débordent, une menace supplémentaire pour une île déjà aux prises avec le choléra. Enfin, l’évaluation technique des bâtiments pour permettre à la mairie de Mamoudzou de planifier la reconstruction. Notre collaboration avec la sécurité civile, encore en sous-effectif, est étroite et nécessaire. Au fil de nos inspections, nous découvrons des tableaux surréalistes : témoin cet arbre entier, suspendu au-dessus d’une cour de récréation, retenu par un unique câble électrique, comme une épée de Damoclès végétale.
Cette mission revêt une importance qui dépasse ses objectifs techniques immédiats. Elle devient le catalyseur d’une cohésion inédite entre les professionnels du bâtiment : architectes, ingénieurs et entrepreneurs de l’île se retrouvent, échangent, s’unissent. Une synergie naturelle s’installe, nous faisons corps face à l’urgence. Pour les agences d’architecture implantées à Mayotte, la situation révèle une particularité saisissante : la majorité des dirigeants — Harrapa, JBA, COA, EH, AIR architecture, L’Atelier architectes… — pilotent leurs structures à distance, depuis l’extérieur du territoire. Dans ce chaos post-cyclone, les réseaux de communication étant coupés, nous, les salariés sur place, nous retrouvons seuls maîtres des décisions. Sans possibilité d’être contactés ou supervisés, nous prenons les rênes de l’urgence. Cette autonomie forcée a un goût de révolution, d’émancipation. L’empowerment naît de la catastrophe : nous découvrons notre capacité à agir, à décider, à nous organiser collectivement.
Après des jours d’engagement physique total, notre expertise d’architecte retrouve sa place. Nos capacités d’analyse reprennent leurs droits dans cette nouvelle mission de diagnostic. Pourtant, une partie du groupe ressent le besoin d’aller plus loin, comme si l’évaluation technique ne suffisait pas à apaiser notre besoin d’action concrète. C’est là que naît l’initiative de Stéphane Aimé, résonnant comme une réponse à notre besoin d’agir : « Chido toit même ». Le jeu de mots capture l’essence même de notre démarche, entre humour et urgence. Une équipe improbable se forme : un professeur, plusieurs architectes et un charpentier, tous unis dans une même mission. Les diagnostics deviennent notre boussole, nous guidant vers les toitures qui, bien qu’abîmées, peuvent être sauvées par des interventions rapides et ciblées. Cette démarche incarne une forme de pragmatisme nouveau, où notre expertise technique nourrit l’action directe.
Depuis les hauteurs de Mayotte, je contemple les cicatrices. Chido, ça veut dire miroir en swahili. Et, tel un miroir, il a mis notre île en lumière. À tout point de vue, nous découvrons sous son voile des quartiers entiers auparavant cachés par les arbres, mais aussi les malfaçons dans les constructions : ici une menuiserie mal fixée, là un mur au chaînage insuffisant. Sur les toits dénudés se lit l’histoire de notre vulnérabilité. Chaque maison raconte sa propre bataille contre les éléments. Il faut déchiffrer ce qui a résisté et ce qui a cédé. Les structures modulaires, pourtant si prometteuses, se sont évanouies comme des châteaux de cartes, vaincues par la fureur du cyclone. Les clous n’ont plus leur place dans nos toitures — l’évidence est là, implacable, écrite dans chaque tôle arrachée. En revanche, les murs en parpaings et en brique de terre compressée se dressent encore fièrement.
La jonction entre la charpente et les murs s’est révélée être le point névralgique de nos habitations. L’inter-lot peut être fatal : les portiques bois ont souvent mieux résisté que leurs cousines plus conventionnelles, simples charpentes posées sur la maçonnerie. Tout dépendait de ces liens invisibles : chaînages et ancrages, ces racines d’acier qui ancrent nos toits aux murs, puis au sol. Le hasard aussi a joué son rôle dans cette tragédie : ici, une toiture transformée en frisbee géant est allée fracasser la demeure voisine, comme un cruel coup du sort. Là, par une ironie bienveillante, une maison a conservé sa charpente en bois, protégée par sa voisine devenue bouclier. Tout le reste autour n’est que chaos — décoiffé, emporté par les vents. Dans cette loterie du désastre, certains ont trouvé grâce, d’autres ont tout perdu.
Le paysage se reconstruit, nous livrant ses leçons. Les bangas renaissent en 48 h tandis que les écoles peinent à se relever. Le cyclone a mis en lumière les défis que rencontre ce territoire dans sa relation avec la métropole : des procédures administratives peu adaptées aux réalités du terrain, une complexité qui ralentit la reconstruction des infrastructures essentielles. Le défi est double : construire vite, mais construire mieux. Alors, au-delà des décombres, une question persiste : saurons-nous collectivement tirer les leçons de Chido ? Ces murs effondrés, ces toits arrachés deviendront-ils les fondations d’un savoir-construire plus résilient pour Mayotte ?
— Lola Paprocki (Linkedin)